Systémique de quoi parlons-nous ?
Le mot « systémique » devient de plus en plus en vogue…
Dans ce qui va suivre, je distingue deux types de « systèmes » :
- Le système avec un petit s : un système plutôt cybernétique, mécaniste. Exemples : le système politique, un système de gouvernance, financier, économique, etc.
- Le Système avec un grand S : une entité autopoïetique quasi vivante (voir plus bas).
En y regardant de plus près, nous pouvons pointer de la systémique à trois endroits :
- Dans la tête de l’observateur/acteur (Observatrice/actrice)
- Dans la relation au Système, via les outils utilisés
- Dans la qualification du système / Système lui-même
La systémique dans la tête de l’observateur(trice)
En nous basant sur le modèle spiral dynamics (les dynamiques en spirale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale_dynamique), le niveau paradigmatique se situe soit dans la première boucle et dans ce cas la structure mentale n’est pas du type pensée complexe/systémique, soit relève de la pensée systémique/complexe, donc de deuxième boucle. Pensée complexe est à entendre ici dans le sens que lui donne Edgar Morin.

Edgar MORIN
Une pensée de type première boucle peut par contre « penser en système » comme le dit le titre éponyme du livre de Donnella Meadows : « thinking in systems ». Cette « pensée en système » est analytique. Elle va chercher à analyser le système afin de le modéliser le plus précisément possible, et pointer les tenants et les aboutissants, les relations et boucles de rétroaction.

Donella MEADOWS
Nous pouvons déjà noter qu’aussi bien Meadows que Morin poèdent une pensée de seconde boucle (GT jaune)
La relation au Système, via les outils utilisés
La systémique a un long parcours. Vous trouverez des information sur sa naissance ou son développement ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
Les « leaders » les plus connus (en France) de la systémique appliquée aux organisations sont (liste non exhautive) :
- L’école de Palo Alto (avec Gregory Bateson, université de Santa Cruz, San Francisco – Californie USA)
- Donella Meadows (MIT, Cambridge, Massachusetts, USA)
- Jean-Louis Le Moigne pour les français
- Et bien d’autres …
L’école de Palo Alto s’est développée autours de la thérapie, donc une relation unipersonnelle. Elle se base sur la boucle circulaire systémique qui relie les comportements (verbal, non verbal et para verbal) du thérapeute et du patients. D’autres éléments se rajoutent à cette circularité :
- Injonctions paradoxales
- patterns (schéma récurrents)
- faire plus de la même chose en s’attendant à des résultats différents
- la solution qui devient tôt ou tard le problème suivant
- nous ne pouvons pas ne pas communiquer
- etc
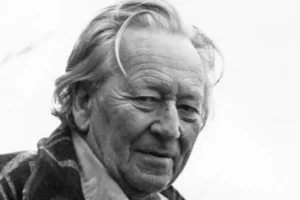
Gregory Bateson
L’approche de Donella Meadows est totalement différente. Elle possédait ce mindset systémique de la deuxième boucle de la SD. Son approche est de modéliser les relations entre les éléments du système/Système, et de chercher les points d’actions pour changer le Système. Elle a définit 12 leviers plus ou moins efficace pour y arriver. Plus le chiffre est petit, plus l’action sur le système est efficace et efficiente.
[12] Les constantes, les paramètres, les nombres (comme les subventions, les impôts, les standards)
[11] La taille des tampons et autres stocks de stabilisation, comparés à leurs flux associés
[10] La structure des stocks et flux de matière (comme les réseaux de transport, les pyramides des âges)
[9] La durée des retards, comparée au rythme d’évolution du système
[8] La puissance des boucles de rétroaction négative, comparée aux effets qu’elles essaient de corriger
[7] Canaliser les boucles de rétroaction positives
[6] La structure des flux d’information (qui a accès ou n’a pas accès à quelles informations)
[5] Les règles du système (comme les incitations, les sanctions, les contraintes)
[4] Le pouvoir d’ajouter, de modifier, de faire évoluer ou d’auto-organiser la structure du système
[3] L’objectif du système
[2] Le Mindset ou le paradigme dont est issu le système – ses buts, sa structure, ses règles, ses retards, ses paramètres
[1] Le pouvoir de transcender les paradigmes
NOTA : en IC systémique et générative, nous ajoutons le levier le plus puissant :
[0] L’homéostasie du Système
le lien vers l’article Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Douze_leviers_pour_intervenir_dans_un_syst%C3%A8me
L’approche de Meadows convient très bien à des Systèmes simples, compliqués ou à faible complexité. Elle devient inefficace avec des Systèmes très complexes, donc avec les Systèmes (auto)adaptatifs complexes qui par définition ne sont plus modélisables.
C’est là qu’en 2016 a émergé l’idée de considéré le Système comme une entité séparée des membres qui le composent. une entité qui est supérieure et différente de la somme de ses parties. d’être un « super organisme », a l’instar des fourmis ou des termites, mais avec des être humains équipés de :
- 80 milliards de neurones dans leur cerveau capital
- environ 40.000 neurones dans le coeur
- environ 200 millions de neurones dans les intestins
A comparer aux quelques 250.000 neurones dans la tête des fourmis!
Cette entité, ce Système, ce Collectif, à des qualités particulières :
- elle est intelligente : elle est capable de prendre de « bonnes » décisions, efficaces ET efficientes.
- elle est sage : elle est capable de prendre des décisions justes
- elle est écologique : rien ni personne ne pâtit de quoique ce soit
- elle est holomorphique : le Système est intégralement présent dans chaque membre, comme notre ADN se retrouve dans chacune de nos cellules du corps.
Il s’agit ici d’une génération de systémique suivant celle de Palo Alto et Meadows. Dans cette systémique le Système devient le client (approche déjà intégrée à l’approche ORSC, coaching systémique d’organisations et de relation), et est considéré comme autopoïetique ( cf Varela & Maturana)
Un Système autopoïetique est une Système quasi vivant. Par rapport à un Système vivant, il lui manques juste :
- la capacité de se nourrir par lui-même
- la capacité de se reproduire par lui-même
- la capacité de s’auto régénérer
Cette nouvelle génération de systémique permet de considérer le Système comme une boite noire (plus besoin de le modéliser) et de tout simplement dialoguer avec lui ! C’est donc le Système lui-même qui, en conscience, va choisir le type de changement qui veut opérer, le changement devient donc intrinsèque et plus extrinsèque. et ceci est une transformation profonde du fonctionnement du Système, son homéostasie devenant motrice et plus résistante au changement. Nous entrons ici dans un changement systémique de type 3 au sens de Palo Alto. Ce type de changement permet un gain de temps d’un facteur 2 à 5 par rapport à des méthodes « classique » de conduite du changement (Levine, Kotter, Bridges et la pire : Kübler Ross!) qui ont un taux moyen de succès de 30% (source McKinsey).
A propos du changement organisationnel de type 3 : https://jfinnov.fr/2021/11/18/transformation-organisationnelle-par-changement-de-type-3/
La qualification du système / Système lui-même
Selon le Mindset de l’observateur développé au premier paragraphe, celui-ci va voir :
- un système plutôt mécaniste, en mode cybernétique de base, qu’il est nécessaire de modéliser pour pouvoir agir sur lui selon notre modèle idéal : changement de type 2 au mieux selon Palo Alto
- un Système autopoïetique, quasi vivant, qui est vu comme une entité intelligente, sage, consciente, avec laquelle nous pouvons engager un dialogue et faciliter son évolution qu’elle aura choisie elle-même : changement de type 3, rapide, fluide et efficient.
Vous voudriez en savoir plus ? Vous avez des enjeux forts ? jacques (at) jfinnov.fr

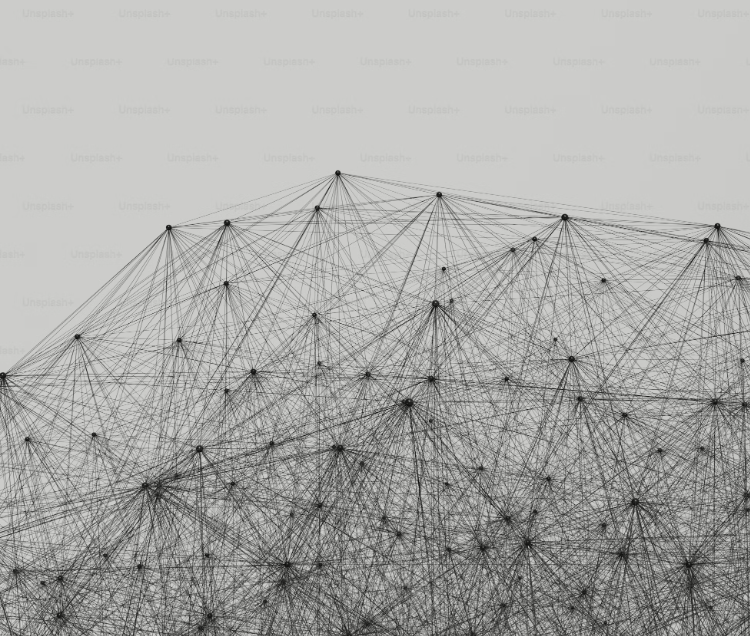
0 Comments
Leave A Comment